Il est ADMYS que les agents publics peuvent bénéficier du report de leurs congés annuels non pris ou de leur indemnisation en cas de fin de la relation de travail.
Jusqu’à présent, en ce qui concerne les titulaires de la fonction publique territoriale, le droit applicable en matière d’octroi des congés annuels était déterminé par le décret du 26 novembre 1985,et notamment son article 5, qui disposait :
« Sous réserve des dispositions de l'article précédent, le congé dû pour une année de service accompli ne peut se reporter sur l'année suivante, sauf autorisation exceptionnelle donnée par l'autorité territoriale.
Un congé non pris ne donne lieu à aucune indemnité compensatrice. »
Ces dispositions interdisaient donc,sauf autorisation exceptionnelle donnée par l’autorité territoriale, le report du congé annuel sur l’année suivant et excluait ainsi qu’un congé annuel non pris puisse donner lieu à une indemnité compensatrice.
Toutefois, la jurisprudence administrative avait constaté l’incompatibilité de ces dispositions avec l’interprétation de la Cour de Justice de l’Union Européenne de l’article 7 de la directive 2003/88/CE du Parlement européen et du Conseil du 4 novembre 2003et avait jugé que :
« Selon la jurisprudence de la Cour de justice de l'Union européenne, ces dispositions font obstacle à ce que le droit au congé annuel payé qu'un travailleur n'a pas pu exercer pendant une certaine période parce qu'il était placé en congé de maladie pendant tout ou partie de cette période s'éteigne à l'expiration de celle-ci. Le droit au report des congés annuels non exercés pour ce motif n'est toutefois pas illimité dans le temps. Si, selon la Cour, la durée de la période de report doit dépasser substantiellement celle de la période au cours de laquelle le droit peut être exercé, pour permettre à l'agent d'exercer effectivement son droit à congé sans perturber le fonctionnement du service, la finalité même du droit au congé annuel payé, qui est de bénéficier d'un temps de repos ainsi que d'un temps de détente et de loisirs, s'oppose à ce qu'un travailleur en incapacité de travail durant plusieurs années consécutives, puisse avoir le droit de cumuler de manière illimitée des droits au congé annuel payé acquis durant cette période. La Cour de justice de l'Union européenne a jugé, dans son arrêt C-214/10 du 22 novembre2011, qu'une durée de report de quinze mois, substantiellement supérieure à la durée de la période annuelle au cours de laquelle le droit peut être exercé,est compatible avec les dispositions de l'article 7 de la directive. » (CE, 14 juin 2017, n°391131).
Aussi, afin de se mettre en conformité avec la directive du 4 novembre 2003, le décret n°2025-564 du 21 juin 2025 relatif aux régimes dérogatoires de report et d'indemnisation des droits à congé annuel dans la fonction publique est venu modifier, pour chaque branche de la fonction publique, les déchets relatifs aux congés annuels. En ce qui concerne la fonction publique territoriale, des articles 5-1 et 5-2 sont ajoutés au décret du 26 novembre 1985, afin de prévoir :
- D’une part, que lorsque le fonctionnaire est dans l'impossibilité, du fait d'un congé pour raison de santé, ou du fait d'un congé lié aux responsabilités parentales ou familiales,de prendre son congé annuel au cours de l'année au titre de laquelle il lui est dû, il bénéficie d'une période de report de quinze mois, dont la durée peut être prolongée sur autorisation exceptionnelle de l'autorité territoriale.
Il est précisé que la période de report débute à compter de la date de reprise des fonctions et que pour les congés annuels acquis pendant un congé pour raison de santé ou un congé lié aux responsabilités parentales ou familiales, ladite période de report débute, au plus tard, à la fin de l'année au titre de laquelle le congé annuel est dû.
Par ailleurs, sauf dans le cas où le fonctionnaire bénéficie d'un report du fait d'un congé lié aux responsabilités parentales ou familiales, le report est limité aux droits non-utilisés relevant des quatre premières semaines de congé annuel par période de référence.
Ainsi, le droit au report de congés annuels est à la fois limité dans le temps, puisque la période de report est limitée à 15 mois, mais également en nombre, puisque le bénéfice du report ne concerne que les quatre premières semaines de congés annuels.
En effet, il serait trop contraignant pour les employeurs de laisser la possibilité aux agents de cumuler trop de congés annuels dont le report pourrait être sollicité, avec le risque de perturber le bon fonctionnement du service.
- D’autre part, que lorsque le fonctionnaire n'a pas été en mesure de prendre son congé annuel avant la fin de la relation de travail, les droits non-utilisés donnent lieu à une indemnité compensatrice.
Le décret précise en outre que, à l'exclusion des droits non-consommés du fait d'un congé lié aux responsabilités parentales ou familiales, cette indemnité ne compense que les droits non-utilisés relevant des quatre premières semaines de congé annuel par période de référence.
Un arrêté, fixant les modalités d'assiette et de calcul de l'indemnité compensatrice pour congé annuel non pris en fin de relation de travail dans la fonction publique territoriale, a été publié le 21 juin 2025 également. Il explicite la rémunération mensuelle brute prise en compte pour le calcul de l’indemnité compensatrice, qui correspond à la dernière rémunération versée au titre de l'exercice effectif des fonctions sur un mois d'exercice complet, et inclut le traitement indiciaire, l'indemnité de résidence, le supplément familial de traitement et les primes et indemnités instituées par une disposition législative ou réglementaire, à l'exception des exclusions prévues à l'article 2 du même arrêté.
Conclusion
Ces nouvelles règles sont applicables aux agents contractuels, puisque l’article 5 du décret du21 juin 2025 supprime les deuxième, troisième, quatrième et cinquième alinéas de l'article 5 du décret du 15 février 1988 relatif aux agents contractuels de la fonction publique et que cet article renvoie aux dispositions du décret du26 novembre 1985.
Ces dispositions sont entrées en vigueur le 23 juin 2025.



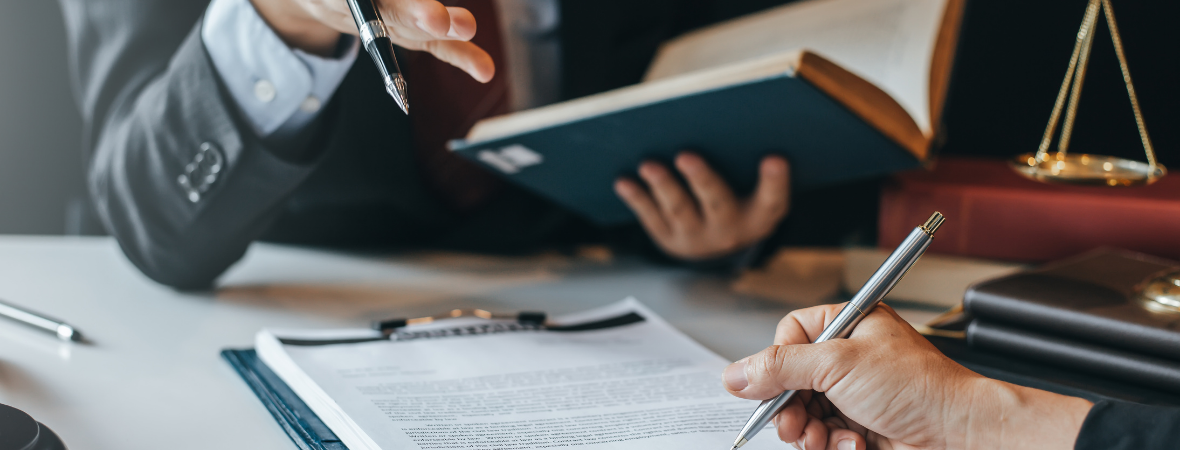














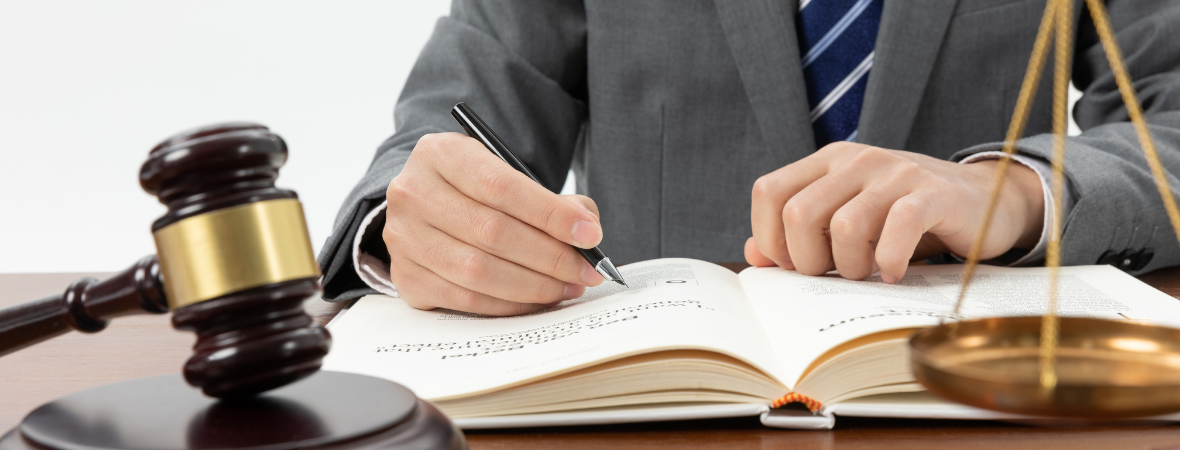
.webp)